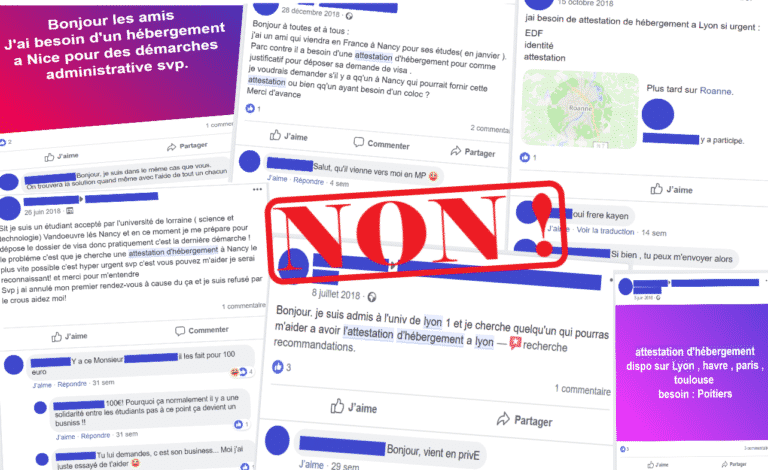Si quelque chose caractérise nos sociétés modernes, c’est bien notre manque de considération pour ce qui est pourtant indispensable à la vie : la nourriture. Tant d’abondance (relativement à l’histoire de l’humanité), pour apparemment si peu de coûts (3% de l’économie française) : miracle de la révolution verte qui nous permet de penser à tout sauf à ce qui entre dans notre assiette… Même lorsqu’on parle de la catastrophe écologique, l’agriculture n’est évoquée qu’en passant, et de façon superficielle. Certes, on consomme trop de viandes, on utilise trop d’engrais, il faudrait aller vers le bio… Mais ces injonctions au ton souvent moralisateur ne font guère avancer les choses. Posons-nous plutôt cette question : comment est-ce que nous en sommes venus à faire de nos champs des zones industrielles ?
Il fut un temps où l’homme vivait en harmonie avec son territoire : non pas qu’il fût plus vertueux qu’aujourd’hui, mais il n’avait pas le choix. On ne pouvait tirer du sol plus qu’il ne pouvait produire, et on ne pouvait manger plus que ce qu’on tirait du sol. Ainsi fallait-il veiller à respecter un équilibre précaire, sous peine de famine. Les plantes devaient être adaptées à la terre, et on ne pouvait élever plus de bêtes qu’on avait d’herbe et de foin. Souvenons-nous de nos cours de SVT : par le mécanisme de la photosynthèse, seuls les végétaux peuvent générer d’eux-mêmes l’énergie dont ils ont besoin pour croître. Les animaux vivent donc grâce aux plantes, même lorsqu’ils sont carnivores (car ils mangent alors des herbivores) ; ainsi, le nombre d’animaux (y compris d’êtres humains) sur une terre était limité par les capacités de celle-ci à produire des végétaux.
De cette contrainte naquit une symbiose entre l’homme et son environnement : car notre activité dépendant de la terre, celle-ci fut fertilisée par celle-là. Les troupeaux vivent des prairies, mais leurs excréments fournissent les sols en sels minéraux. Et les hommes durent trouver pour chaque sol les plantes qui y poussaient le mieux : ainsi nos pays furent-ils le lieu d’une formidable diversité, chaque région ayant sa spécialité. La campagne française fut ainsi forgée par le dialogue harmonieux entre culture et nature : beauté d’un paysage modelé par le travail paysan, travail des créatures humaines fondé sur le respect de la Création… L’homme répondait ainsi à sa vocation : mettre en acte la puissance contenue dans la terre, découvrir la cause finale de la nature qui l’entoure…
Mais notre orgueil a voulu nous affranchir de ce cadre reçu, imposé : notre soif de liberté, qui s’exprimait jusqu’à alors au sein d’un monde limité, finit par nous engouffrer dans le rêve de l’illimité. L’industrie devint notre principale préoccupation, porteuse qu’elle était de nos chimères de faste universel et de progrès indéfini; tandis que la paysannerie incarnait l’ancien monde, engourdi et réactionnaire, à abolir. Elle resta pourtant la catégorie majoritaire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, silencieuse et résiliente, retrouvant durant les crises un éphémère prestige (on pense aux parisiens mendiant des poules aux campagnards durant le rationnement allemand).. Mais la folie progressiste des «Trentes Glorieuses» porta le coup fatal à ce socle immémorial des sociétés européennes : un homme nouveau devait naître, émancipé de son cadre naturel, autonome et hors-sol…
Des semences plus productives furent importées, en même temps qu’une profusion de machines et d’engrais; la plupart des haies et des petits taillis qui divisaient les champs et les faisaient respirer furent rasés, et on créa des parcelles immenses et rationalisées, à l’américaine. Quelle effervescence ! Les gains de productivité furent en effet multipliés. On put créer cette population d’urbains propres, lisses et branchés dont on avait tant rêvé… Mais à quel prix ?
D’abord, la destruction de la vie villageoise. Même les ruraux voulurent devenir citadins : le paysan devint un exploitant agricole, gérant son champ comme un industriel. Les froids raisonnements cherchant à optimiser à tout prix les ressources prirent la place des habitudes ancestrales. L’homme, qui avait sa juste place dans l’univers, se coupa de celui-ci, se plaça en maître orgueilleux. Plus de mariage, mais un viol. Et la sublime culture de nos pères, résultat de leur union avec la mère nature, fut remplacée par une zone neutre, sans sève ni saveur, campagne abâtardie où règnent les tracteurs. Que les villages soient ou non désertés n’y change pas grand-chose : leur raison d’être n’est plus. L’homme antique et médiéval, fils du paganisme et du christiannisme, est devenu un ingénieur et un technicien, fils du scientisme et du capitalisme.
Ce changement de paradigme n’a pas eu seulement des conséquences esthétiques et spirituelles : ce Règne de la Quantité (René Guénon) provoqua naturellement une chute de la qualité. Car pour faire pousser les nouvelles semences plus productives, il fallut des intrants artificiels, dont on ignore plus aujourd’hui la nocivité, à la fois sur la santé du producteur, du consommateur, et sur les espaces où ils sont rejetés. Quant aux bêtes élevées en batterie, gavées d’OGM et dopés aux protéines, elles n’ont rien à voir avec celles qui broutent paisiblement dans les vertes prairies… Pollution de nos organismes et de nos terres, de nos fleuves et de nos mers, prix à payer d’une abondance alimentaire… qui risque de n’être même pas pérenne.
En effet, ce système n’a pas été conçu pour être durable, mais pour avoir le plus de rendements immédiats. Le monde traditionnel est cyclique : tout ce qui est consommé est réintégré d’une manière ou d’une autre à la terre qui l’a engendré. Or, les urbains qui consomment la nourriture ne peuvent évidemment pas redonner au sol les nutriments qu’il a perdu lors de la récolte. La différence est compensée par les engrais chimiques, produits grâce aux énergies fossiles. Et qui dit énergies fossiles dit énergies épuisables. Certes, ce n’est pas pour demain la pénurie me direz-vous (quoique avec le contexte géopolitique aussi tendu, on ne sait pas); mais le fait de vivre d’une façon intenable sur le long terme devrait être insupportable aux hommes qui s’inquiètent de leur postérité.
Ainsi tout être humain qui veut transmettre sa vie doit chercher à assurer l’autosuffisance alimentaire de sa communauté : nous en sommes loin. Mais n’est-ce pas là un formidable projet pour notre peuple qui a perdu le sens de sa destinée? La France, grenier historique de l’Europe, foyer de ces monastères qui améliorèrent grandement la production agricole (on pense aux granges cisterciennes), pourrait tenter de relever le défi de notre siècle : retrouver une agriculture en harmonie avec la nature, capable de nourrir pour des siècles et des siècles tout un pays. N’a-t-on pas le droit de rêver? Tant qu’on agit pour réaliser nos rêves, bien entendu …
Et c’est un rêve possible : les études montrent que, du moins pour le maraîchage, la permaculture est aussi productive que l’agriculture intensive…à condition d’avoir beaucoup plus de main d’œuvre. Si on ne va pas tous devenir paysans du jour au lendemain, on peut déjà se mettre à consommer d’avantage local et bio, à manger moins de viande mais de meilleure qualité, et plus généralement à donner davantage d’attention à ce que l’on mange. Il n’est pas forcément nécessaire d’augmenter le budget alimentation (quoi qu’il soit trop faible pour l’importance de la chose) : renoncer aux produits déjà transformés au profit de meilleurs produits bruts peut être suffisant pour retrouver une alimentation saine. Et peut-être que cet intérêt renouvelé pour la nourriture saura réveiller des vocations paysannes …