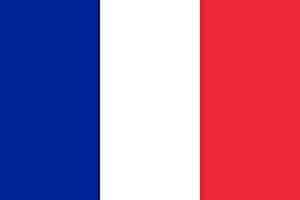La crise sanitaire, qui se double désormais d’une crise économique et sociale, a largement relégué au second plan un autre aveu d’impuissance de l’Union européenne : sa capacité et surtout sa volonté de soutenir un « État membre », la Grèce, face à une puissance étrangère hostile, la Turquie. Retour sur cette question.

Le 28 février dernier, par décision unilatérale du président turc Recep Tayyip Erdogan, les frontières de son pays avec l’Union Européenne sont déclarées ouvertes. Des milliers de migrants, convoyés gracieusement depuis Istanbul par des édiles de l’AKP, parti islamiste au pouvoir en Turquie, se rassemblent devant la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie fixée le long de l’Evros depuis le traité de Lausanne de 1923. Au même moment, des dizaines de canots pneumatiques, remplis de réfugiés, s’échouent sur les rivages des îles Grecques de Lesbos et de Chios. Loin de l’image rêvée de lieux d’amours saphiques, ces îles sont devenues de véritables cloaques où s’entassent des milliers de migrants, réfugiés, exilés ou illégaux – le terme est au choix du lecteur – attendant une hypothétique décision administrative leur permettant d’atteindre le continent européen, et avec lui, l’eldorado espéré de l’ouest européen, dont les largesses sont connues, et espérées, de Nouakchott à Islamabad.
Cette crise en rappelle une autre : début 2015, la même situation s’était présentée aux frontières européennes. Une Grèce submergée et ruinée avait fait appel à ses partenaires continentaux. À l’époque, la chancelière Merkel avait ouvert ses frontières. Au slogan de “wir schaffen das” (nous y arriverons) près d’un million de réfugiés syriens avait traversé les Balkans pour rejoindre la terre promise germanique.
Depuis, avec la progression des scores de l’AfD et la baisse sensible de la vie nocturne féminine à Cologne, l’eau a bien coulé sous le pont de Kehl. L’appel d’air allemand ne pouvait et ne devait être qu’un acte unique. Aussi, dans la foulée et pour essayer de résoudre la crise, la chancelière allemande négocie-t-elle avec Erdogan, fin 2015, un accord de gestion des migrants. Officiellement signé le 18 Mars 2016, il constitue encore, du moins sur le papier, le socle de la relation migratoire entre l’UE et la Turquie.
Il repose sur deux piliers. Un volet financier tout d’abord ; près de 6 milliards d’euros doivent être distribués à des ONG assurant la gestion des réfugiés présents sur le territoire turc. Un second volet se traduit par la règle sortie tout droit d’un cerveau technocratique bruxellois, celle “d’un Syrien pour un Syrien”. Ainsi, pour un réfugié syrien arrivé illégalement sur le territoire européen et renvoyé en Turquie, un autre pouvait en partir par un corridor humanitaire sécurisé et rentrer en toute légalité sur le territoire européen. Cette règle, qui devait concerner 72 000 personnes, n’a, sous la pression des pays d’Europe de l’Est, contribué que pour 21 163 entrées (chiffre FRONTEX) sur le territoire européen. Mais seuls 1 843 réfugiés (sic) furent effectivement renvoyés de Grèce en Turquie.

Cet accord constitue une reddition en rase campagne de la gestion du flux migratoire aux frontières sud est de l’Union Européenne par Ankara. Malgré tout, le résultat, à court terme, fut au rendez-vous : les entrées illégales sur le territoire européen ont été jugulées, bien que la pression migratoire ne soit jamais totalement retombée. Mais cet accord avec Ankara a davantage consacré un répit qu’une solution pérenne. Il donnait en vérité à Erdogan un formidable levier de pression sur l’UE, activable à tout moment pour pousser les européens à (re)sortir le chèque pour calmer Ankara.
Les raisons du revirement actuel d’Erdogan sont multiples.
Il faut y voir un objectif de ménagement de l’opinion publique turque, de plus en plus sceptique à l’égard de l’action néo-ottomane de son président. En effet, son aventure militaire en Syrie s’est révélée plus ardue que prévue. L’armée turque, plus habituée à réprimer des manifestations kurdes, s’est cassée les dents face à une armée syrienne aguerrie et appuyée par les forces russes. Les gestes effectués par les Loups-Gris lors des matches de football, arborés par les supporters et les joueurs, ainsi que les rodomontades twittoresques des turcs expatriés en Europe n’ont pas pu camoufler les déculottées subies par l’armée turque. De plus, de par ses entreprises belliqueuses, la Turquie doit subir des sanctions économiques américaines lourdes mettant à mal sa stabilité monétaire et son tissu économique. Enfin, la présence de près de 4 millions de réfugiés syriens, dont le flux d’arrivée vient de reprendre du fait même de l’intervention turque (!), commence à exaspérer la population.
Sous le prétexte d’un “partage du fardeau”, Recep Tayyip Erdogan a donc lancé une opération à grande échelle de déstabilisation des frontières de l’Union Européenne.
Pour l’UE, gouverner c’est communiquer
L’Union Européenne, parlons-en. Cette crise politique et diplomatique était l’occasion pour la nouvelle Commission von der Leyen de faire la preuve de son efficacité. La période était propice : l’épidémie de COVID-19 n’avait pas encore atteint le continent ; la commission avait présenté son Green New Deal, certes, dans le désintérêt le plus total des opinions publiques. Mais cette crise était le moment de prouver à l’Europe et au monde entier la solidité retrouvée de l’Union et sa capacité à parler d’une seule voix.
Une fois de plus, l’UE ne fut pas au rendez vous.
La communication avait pourtant été intensément préparée : dès le 3 mars, la Présidente de la Commission, le Président du Parlement et le Président du Conseil (Ursula Von Der Leyen, David Sassoli et Charles Michel) se rendaient en Grèce soutenir le Premier ministre Grec Kyriakos Mitsotakis. Frontex annonçait de nouveaux moyens à la frontière orientale de l’UE, et M. Michel devait rencontrer le Président Erdogan le 4, alors que se réunissaient les ministres de l’intérieur Européens dont on attendait un communiqué prouvant leur position de fermeté.
« Qui imagine Gérard Larcher visiter nos troupes au Mali ? »

La visite du “Soviet Suprême” Bruxellois se montra déjà particulièrement comique. La présence du président du Parlement Européen, le socialiste italien Sassoli se révéla aussi incongrue qu’inutile (qui imagine Gérard Larcher visiter nos troupes au Mali ?). L’Union, tentant par les voix conjointes de la présidente de la commission et du président du conseil, d’apparaître ferme dans le domaine régalien et dans celui des frontières, ne put qu’apporter un soutien poli à l’action du premier ministre grec en affirmant l’unité européenne face au “chantage” du président Turc. Quant à la visite des instances européennes à Ankara, le communiqué final mentionna des “discussions franches” entre les parties. Pourtant, l’initiative européenne ne pouvait conduire qu’à une impasse : l’Union s’accrochant encore à l’accord du 18 mars 2016, qui, de fait était rendu caduc par le non respect évident de l’accord liant Ankara à Bruxelles.
Quant à l’unité et la fermeté de la position du Conseil Européen, la presse révéla que les termes initiaux “le conseil européen condamne fermement” furent biffés par le feutre germanique, contre la mention d’un timide “ferme rejet” (sic) de l’attitude turque. Cette crise révéla encore, aux rares personnes qui en doutaient, que l’organisation actuelle de l’Union Européenne rend impossible toute action ou position commune, tant sur le front de la politique migratoire que sur d’autres sujets. Pire, cette impuissance collective tend du même coup à décrédibiliser individuellement chacun de nos États sur la scène internationale !
La Grèce livrée à son sort
Pourtant, les 15 000 migrants aux abords des clôtures grecques furent bloqués. La Grèce, par la voix de son Premier ministre, assuma “la défense de la souveraineté de son pays” et déclara que “personne ne passerait”. Quand l’UE s’estompe, les États réapparaissent. On peut raisonnablement, et en attendant les événements futurs, se féliciter de l’attitude du premier Ministre grec Mitsotakis. Les férus de politique grecque n’auraient reconnu en lui qu’un “fils de”, en l’occurrence fils de Constantin, Premier ministre de 1990 à 1993, fâcheuse habitude de la politique grecque des “dynasties” familiales. Pourtant, il faut souligner la fermeté du gouvernement grec, qui tranche avec l’apathie de celui de Tsipras, dont la mollesse pour défendre son peuple fut proportionnelle au respect de ses frontières.
Néanmoins les mobilisations numériques du camp national et le succès du mot-dièse IStandWithGreece ne peuvent dissimuler la profonde fragilité de la Grèce. De deux choses l’une : sur l’Evros, la Grèce est dans son bon droit : une frontière terrestre ne se traverse pas comme cela et il est dans les prérogatives des États d’empêcher, par tous les moyens, que ses frontières soient illégalement franchies. La situation sur la frontière maritime est plus complexe, et même si le nécessaire secours des naufragés n’engendre pas leur accueil voire leur installation, dans les faits les arrivées par bateaux représentent un flux difficile à tarir, sauf à utiliser des moyens de pressions et de défense d’un “charlisme” relatif, et, empressons-nous de le dire, totalement interdits dans l’Union Européenne, farouche gardienne des “droits fondamentaux”.
Cette crise révèle une réalité assez invisibilisée de la situation migratoire en Méditerranée. Un article du Monde (04 Mars 2020) moquait les imprécations du président hongrois renforçant sa frontière méridionale et consolidant son mur le long de la frontière serbe. Or, et en contradiction avec le persiflage journalistique envers les autorités hongroises, les entrées illégales via la frontière hongroise ont augmenté de 132% en un an (!). De plus, on apprend aussi que seulement 33% des migrants comptabilisés en Grèce par Frontex étaient effectivement des Syriens, la majorité étant des Pakistanais et des Afghans, et l’on dénombre même 11% d’Algériens et de nombreux subsahariens.
Ces chiffres nous renvoient à une réalité brutale : il y a des chemins de migrations souterrains entre l’Afrique, la Turquie et l’Europe. Les routes migratoires ne sont pas étanches, mais de Libye, via l’Egypte, le Liban, voire la Syrie, sans doute des migrants sont utilisés pour servir de monnaie d’échange à l’État turc au mieux (sic), aux mafias au pire (les deux se confondant de plus en plus avec le temps). La Turquie est devenue la plaque tournante des flux migratoires vers l’Europe.
Souveraineté égoïste et eurosclérose collective

L’impuissance de l’Union européenne est à l’origine des pires politiques unilatérales des États. L’incurie d’une politique européenne commune les entraîne dans une politique de “passager clandestin”, chacun essayant de se ménager les bonnes grâces du président turc afin qu’il détourne les flux migratoires de leurs frontières. L’attitude de la Bulgarie, voisin de la Grèce, est un exemple paroxystique de cette politique. Le Premier ministre, Borisov fait office de porte-flingue du président turc à Bruxelles, ne cachant pas ses relations d’amitié avec celui-ci. Cette position, motivée par des obligations intérieures ( une minorité turque représentant entre 15 et 20% de la population) et des impératifs extérieurs, n’est pas dénuée d’effets. En effet la Bulgarie subit dix fois moins d’entrées illégales sur son sol que la Grèce (chiffres FRONTEX). La Bulgarie étant il est vrai aussi aidée par la “mauvaise réputation” dont elle jouit dans les foules migratoires en raison de l’attitude on ne peut moins accueillante de ses gardes-frontière (violence, tirs à balles réelles, et autres joyeusetés…).
Loin d’une solidarité européenne affichée fièrement, les États européens se refilent la patate chaude migratoire. Soit en détournant de leurs frontières les migrants, soit en refusant toute idée de répartition des migrants arrivés sur le territoire européen, laissant les pays d’accueil seuls pour gérer ces masses. L’attitude des pays d’Europe centrale et orientale est de ce point de vue on ne peut plus emblématique. Le premier ministre polonais Morawiecki, comme le chancelier autrichien Kurz, n’ont pas manqué de féliciter la fermeté d’Athènes. Vienne a même accueilli en grande pompe le premier ministre Mitsotakis en soulignant la nécessité de tenir les frontières extérieures européennes. Pourtant, Vienne, Varsovie ou Budapest se montrent beaucoup moins diserts quand le peuple grec est écrasé sous le poids des mémorandums et saigné par les plans d’austérité qu’on lui impose, et se montrent absolument opposés à toute politique de répartition des migrants en Europe.
La situation est risible. On pourrait se féliciter que l’UE prouve encore son inutilité et que les États reprennent leur capacité d’action. Pourtant et contre Ankara, c’est bien une position commune qu’il faut trouver. Tant que la division perdurera, c’est bien Erdogan qui donnera le tempo de la crise. Un cercle vicieux s’est donc formé. Ankara envoie ses migrants, l’Union européenne, divisée et effrayée, paye.
L’Allemagne soutient ce statu quo, les subsides envoyés lui coûtant sans doute moins cher qu’un siphonnage de l’électorat CDU par l’AfD du fait d’une intégration toujours plus difficile des nouveaux arrivants. La Chancelière a même proposé de verser directement à l’Etat turc les aides européennes ! C’est à la France d’assumer une réelle position de fermeté : que les robinets de l’argent européen soient coupés tant qu’Ankara ne respecte pas l’accord de mars 2016. Et si les migrants s’agglutinent aux frontières grecques, l’Europe doit soutenir Athènes coûte que coûte. Elle pourrait ainsi desserrer l’étau financier qui étrangle l’économie hellénique.
Car, il faut bien comprendre que le maillon faible dans cette affaire est bien la Turquie : celle-ci est totalement dépendante des aides européennes, seules à même de maintenir les réseaux de clientèle et de charité islamique organisés et gérés par l’AKP.
Ainsi, l’Europe s’embourbe. Par l’existence d’institutions supranationales batardes, obligeant les États aux intérêts divergents à accoucher de compromis hasardeux, toute situation prise en charge par Bruxelles se termine dans une pantalonnade confuse et grotesque. Seule une coopération raisonnée entre les États pourrait nous sortir de l’impasse, quitte à passer sur le corps putréfié des institutions bruxelloises.