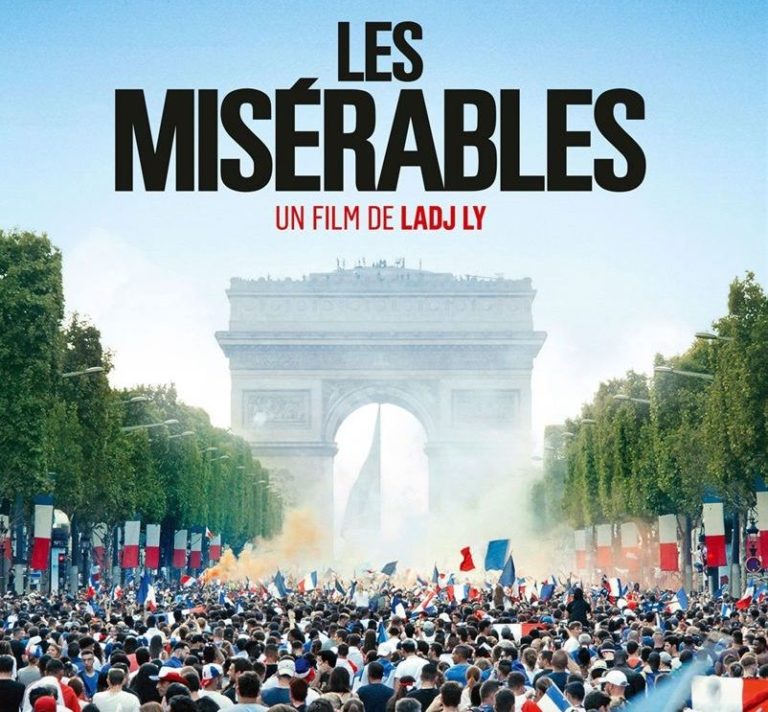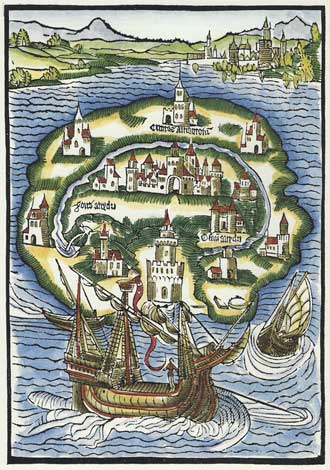La théorie du « genre » est censée ne pas exister et n’être qu’un fantasme des « réacs » de tous bords. Elle est pourtant omniprésente dans les universités françaises derrière le nom d’ « études de genre » qui lui sert de camouflage. La liste est longue des universités qui brandissent fièrement l’ouverture ou la consolidation de leurs diplômes spécialisés en « gender studies ».
Premiers signaux sensibles Dans l’imaginaire collectif du camp conservateur c’est forcément la gauche qui a distillé ces thèmes, notamment par l’intermédiaire du ministre de l’Éducation Najat Vallaud-Belkacem et son programme d’« ABCD de l’égalité » (dont l’expérimentation, lancée par Vincent Peillon, avait été préalablement validée par Benoît Hamon). Il était question de lutter contre le sexisme et les « stéréotypes » de genre à l’école primaire, jargon sociologique pour en fait dire : « casser les manières d’être un homme ou une femme spécifiques à notre civilisation ». « Soyez comme vous êtes ! » était le nouveau credo, comme s’il existait une neutralité originelle qui devait être préservée de tout « stéréotype » de genre. Ces annonces n’avaient pas manqué de soulever des protestations légitimes, mais bien vite catégorisées comme des manœuvres de « l’extrême-droite réactionnaire » (La Manif pour tous) et des réseaux soraliens alors très influents sur la toile. On oublie pourtant souvent que c’est sous un gouvernement de droite et son ministre Luc Chatel que les thèmes du genre ont vraiment fait surface en France, notamment avec le chapitre « devenir homme ou femme » du programme de SVT de plusieurs manuels destinés aux classes de Première. Vincent Peillon, alors ministre de l’Education nationale et Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des Femmes, dans une classe maternelle de l’école Château Gaillard à Villeurbanne, où les ABCD de l’Egalité ont été expérimentés (le 13 janvier 2014). Crédit DD/Rue89Lyon.
L’on comprend aisément que ce qui touche à l’enseignement à des niveaux où les parents sont encore fortement impliqués dans les études de leurs enfants ait rapidement fait débat et suscité une levée de boucliers. Mais il est à regretter que l’opposition ne soit pas aussi forte en ce qui concerne les amphithéâtres et les laboratoires de recherche de nos universités. C’est en effet ici que sont mijotées les petites nouveautés idéologiques qui ne manqueront pas, à force de lobbying associatif et de pétitions, de grimper jusqu’au niveau des circulaires ministérielles et des nouveaux programmes d’éducation. Après tout, pourquoi s’en offusquer ? Pourquoi ne pas s’en féliciter ? Pourquoi prendre le risque d’être renvoyé une fois de plus dans le camp des contempteurs du Progrès et devoir à coup sûr passer sous les fourches caudines des chasseurs de « phobies » ? Le genre : de quoi s’agit-il ? Enfanté en 1955 par le psychologue John Money – dont les expérimentations tragiques aboutiront en 2004 au suicide de son patient le plus emblématique, David Reimer -, le concept de « genre » s’est dès le départ opposé à la prétendue « rigidité » du sexe biologique en prenant pour modèle les cas rarissimes d’hermaphrodisme.
Le genre a fait du chemin depuis, il nous dit que nous ne sommes en rien déterminés par notre sexe biologique (mâle ou femelle), que nous pouvons nous défaire de cette encombrante détermination que nous n’avons pas choisie, et que pour cela il suffit de se dire « homme » ou « femme » pour être un homme ou une femme. John Money (1921-2006), inventeur du concept de « genre » Avec le genre, l’humanité devient une vaste scène de théâtre où chacun joue un rôle et peut en changer quand il le désire. Si je me revendique et me sens femme et lesbienne le matin, qu’est-ce qui m’empêche de me sentir homme et hétérosexuel le soir, à partir du moment où seul le discours compte et où le corps est jeté dans les poubelles de l’histoire ? C’est l’ « immense bénéfice du blabla » décrit par Dany Robert Dufour : l’Homme, contrairement à l’animal, peut « parler » sur lui-même, et se prendre pour ce qu’il n’est pas. Les promoteurs du genre à l’université avancent sous couvert de proposer un objet d’étude radicalement nouveau, qui permettrait un regard neuf sur l’histoire de nos sociétés. Or il n’en est rien.
D’une part parce que reconnaître que de la « culture » se superpose à la « nature » n’a rien de subversif et est même aussi vieux que l’humanité, d’autre part et surtout parce que là n’est pas leur véritable objectif. Montrer que le masculin et le féminin sont des constructions sociales est l’étape qui précède la déconstruction de ces catégories et l’avènement de la « révolution anthropologique » dont parle Jean-François Braunstein dans La Philosophie devenue folle (Grasset, 2018). Le plus souvent répandue par des militants « engagés », qu’ils soient chargés de TD, maîtres de conférences ou professeurs, la théorie du « genre » est un instrument qui s’atèle à réduire en poussière certains des murs porteurs de notre civilisation, et dont le plus fragile est justement celui de notre relation particulière entretenue entre les femmes et les hommes. Les Européens, et la France en particulier, ont exalté l’énigme de cette première différence qui se découvre à l’œil nu, laquelle a accouché largement de leurs Arts et de leurs Lettres. Ceci n’est pas un homme. Les parties de Qui est-ce ? vont se complexifier… Faut-il brûler les « préjugés » ?
Il nous faut prendre le contre-pied des « déconstructeurs » et dire que c’est justement parce que le féminin et le masculin – tels que nous les avons patiemment conçus – sont des constructions historiques qu’il faut les protéger, et non s’en débarrasser. Seules les choses éternelles n’ont pas besoin de défenseurs. C’est en cela qu’il ne s’agit absolument pas d’un sujet purement méthodologique propre à l’université. Il doit être mis au cœur de la Cité. Nous sommes en passe de devenir la première civilisation qui alimente son déclin au nom de la « lutte-contre-toutes-les-discriminations » et de la fin des « préjugés ». Nos adversaires sont très forts, ils sont parvenus dans un premier temps à associer tout « préjugé » à quelque chose de péjoratif, puis à faire l’amalgame entre préjugé et héritage culturel. Dès lors, la table rase tant souhaitée peut se réaliser sans le moindre obstacle puisque tout ce qui porte la trace du passé est négativement connoté, et sa disparition saluée au nom de l’ « émancipation » et du « progrès ».
Sachons contrer cette manœuvre de travestissement sémantique, et Edmund Burke peut nous être ici d’un secours bienvenu. Suivons-le lorsqu’il écrit qu’ « au lieu de secouer tous les vieux préjugés, nous y tenons au contraire tendrement ; et j’ajouterai même, pour notre plus grande honte, que nous les chérissons parce que ce sont des préjugés – et que plus longtemps ces préjugés ont régné, plus ils se sont répandus, plus nous les aimons. » Edmund Burke, Réflexions sur la révolution en France (1790) Nous ne sommes pas « jetés dans le monde » nus comme des vers ! Les préjugés sont là pour nous guider, nous orienter, et éviter que tout soit à recommencer à chaque nouvelle génération. Aucun homme n’est le premier homme, et il serait folie que de vouloir se débarrasser de nos boussoles du masculin et du féminin. Sommes-nous démunis face à la théorie du « genre » ?
Alors que faire si l’on ne veut pas en rester aux lamentations stériles ? Bien que le terrain soit miné et que partout sont débusqués les hérétiques, ceux qui persistent à penser que le sexe n’est pas qu’une construction sociale et que la nature peut parfois compter doivent sortir du silence. Plusieurs essayistes de renom n’hésitent pas à dégainer leur plume ou à s’exprimer sur les plateaux télés (pensons à Eugénie Bastié ou à Bérénice Levet) ; c’est une très bonne chose. Des pistes plus directes sont également à envisager pour un gouvernement qui voudrait prendre ce sujet à bras-le-corps, à l’instar de la Hongrie où, par un décret annoncé cet été et entré en vigueur en octobre dernier, le premier ministre Viktor Orban a exclu les études de genre des cursus reconnus officiellement par l’État, mettant ainsi fin à leur financement public.
L’on peut enfin croire et espérer que tout ceci n’est qu’un effet de mode. Rappelons qu’à la fin du XIXe siècle, la psychiatrie avait inventé la dromonie (ou folie ambulatoire), et que l’on avait alors vu se multiplier d’étranges « voyageurs fous », qui disparurent cependant très vite une fois passé l’effet de « mode ». Nous pensons qu’aujourd’hui, avec le genre et ses déclinaisons sans fin, nous sommes peut-être en train d’assister à un phénomène semblable. Des théoriciens, psychologues et sociologues s’en donnent à cœur joie dans la production de nouvelles « identités » (LGBTQ et ainsi de suite), ce qui permet à certains de se conforter dans leurs appartenances imaginaires.
Lorsque la logique sera allée trop loin, ou que l’effet subversif sera dissipé, alors il n’est pas exclu que nos sociétés se réconcilieront avec la part de nature qui est en chacun d’entre-nous.