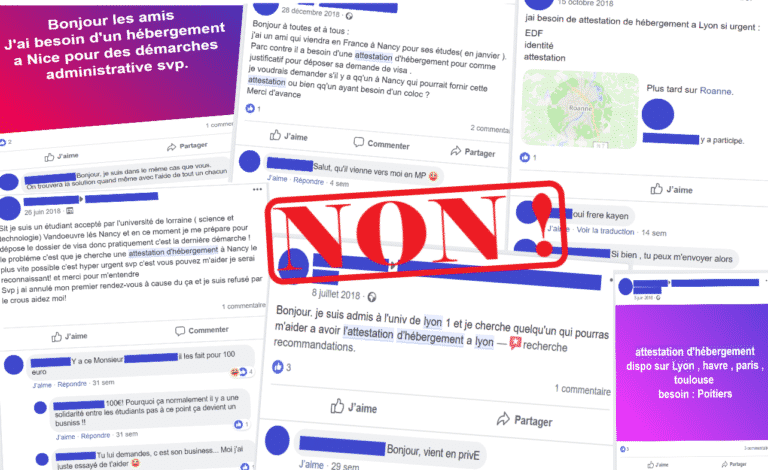Puisqu’aucune saillie n’est relative, puisqu’il faut exprimer sa pensée sans godiller, au risque de heurter les bonnes âmes, au risque d’aller trop loin et de franchir les convenances établies par la société bourgeoise, nous nous sommes drapés, le temps d’un instant, dans le costume du méchant, qui nous sied tant, afin d’élire la mauvaise foi, la bile et la colère, ferments de tant de vérités…
Que valent les ruines si elles ne subsistent que par assistance respiratoire, comme les fragments d’un monde disparu, que valent-elles si elles ne sont qu’objets de névrose, de mélancolie, de fatalisme et d’angoisse ? Autant les détruire, les anéantir, les pulvériser, les jeter dans l’abîme des souvenirs, les noyer dans le Léthé. Si elles demeurent, elles nous hantent et nous taraudent au point de nous paralyser. Aux panégyristes du musée, aux écornifleurs, n’oubliez pas que l’art populaire et savant vit par son activité et meurt par ses taxidermistes.
La culture de la ruine
Paul Valéry, dans La Crise de l’esprit, caractérise la modernité comme une époque frappée du sceau de la confusion, et dans laquelle coexistent pêle-mêle, des idées incompatibles et des principes contradictoires. Je fis moi-même l’expérience de cette confusion éclectique, que Max Weber a affublé du nom de polythéisme des valeurs, et dont je n’étais qu’à demi conscient, quand, drapé d’une curiosité bondissante et enhardie dans la volonté de me repaître d’une culture millénaire, j’entrepris de me rendre au musée. Citadelle du beau, havre de la tradition, tour d’ivoire assiégée par la houle de boue qui menace ses remparts, le musée, si l’on en croit ses panégyristes, est cet îlot de grâce au milieu du monde moderne décrépite. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, ayant poussé la porte du musée, je fus aussitôt confronté à une myriade d’artefacts bigarrés, dont l’agencement semblait être le fruit d’une malheureuse conjoncture. J’eus la forte impression, celle dont je garde encore un souvenir vivace, d’avoir été transporté au beau milieu d’une foire aux portes béantes dont les étalages débordaient de partout. Un bazar bourgeois certes, mais un bazar tout de même.
Que le lecteur ait la diligence de me pardonner cette audace comparative, mais dans l’effort maladroit et désordonné de vouloir faire revivre une culture européenne à l’agonie, le musée s’ébroue à étaler vulgairement ces vieux souvenirs, comme un geste de désespoir d’une ultime défense. Dans le registre de la mémoire le musée fouge la consolation qui l’arrachera à la réalité désenchantée dont il ne parvient pas à affronter la cruauté. Jean Baudrillard avait scrupuleusement relevé cette angoisse qui réside dans le lien étroit unissant la collection et la mélancolie. C’est l’impasse stérile qu’ont connue les romantiques, partagés entre courage et lâcheté. Le courage de regarder par-dessus leurs épaules un passé vertigineux, et la lâcheté de s’y jeter éperdument en désertant l’ici et maintenant auquel ils devaient hélas faire face. Le musée est ce lieu sinistre où les objets se piétinent, où les siècles se coudoient, où les modes et les goûts se juxtaposent sans distinctions et sans hiérarchie. Dans ce chaos baroque les contradictions s’empilent et s’entassent comme de vieux débris bradés à l’occasion d’une brocante familiale. À travers ces objets, l’homme moderne, labouré par la cohabitation monstrueuse de l’anxiété et de la rêverie, vit par procuration comme le vieillard qui s’appuie sur sa béquille et n’avance que péniblement. Englué dans cette illusion palliative et mirifique, il est incapable de faire face à l’infini et riche solitude que son âme requiert, et tente donc, fiévreusement, de combler ce vide par l’accumulation.
Le musée préserve-t-il nos trésors de manière désintéressée ? En aucun cas, son commerce est dissimulé, sournois et tacite. Ses recettes ne s’adossent-elles pas sur le pillage et la spoliation ? Si les tentatives de Malraux (avide voyageur dont l’ivresse marchande lui valut d’être épinglé par la police thaïlandaise) ne furent pas couronnées de succès, celles de l’État français le furent, et ce dernier, dans sa fausse majesté gonflée d’orgueil, ne s’est pas gêné pour faire profit des productions chrétiennes. Il a chassé d’une main le christianisme, prétendant émanciper les Français de son empire chimérique, et de l’autre, s’est emparé de tous ses biens matériels, comme l’enfant ingrat dont la gloire réside dans cette parenté qu’il exploite. Ainsi le musée de Cluny, situé dans le doucereux quartier latin, expose fièrement les productions du Moyen-Âge très chrétien, comme les derniers fragments d’un monde disparu. En prétendant faire la promotion du Beau, le musée parachève son anéantissement. Mis sous cloche et parqué dans une réserve, le voilà prisonnier derrière les fils de barbelés supposés lui garantir la volupté d’un confort sans pareil. Bernard Charbonneau, pionnier de l’écologie authentique, écrivait en 1969 : «Le parc national n’est pas un jardin, mais un morceau de nature artificiellement conservé par la loi. […] Cette nature qui survit sous la surveillance d’une police n’est plus la nature. […] Le parc national n’est qu’un suprême artifice, […] un produit de l’organisation sociale.» De son vivant, Charbonneau avait à faire face à une colonne de silence (pour paraphraser Léon Bloy) et maintenant qu’il est mort, il doit encore affronter l’oubli du tombeau. Ce qu’il nous disait est à mettre en relation analogique avec la place du musée dans notre société. Les citadins mus par une quête de villégiature ont construit dans les villes des parcs et des jardins, et ce faisant, ils ont porté le coup fatal à cette «nature mise en cocon, isolée du reste de l’univers.» Le musée est à l’art ce que le jardin public est à la nature, l’ultime trahison, le baisé de Judas qui, derrière des aspects bienveillants, cache la pire des turpitudes.
Au travers du musée que j’avais idéalisé, je cherchais un échappatoire, un dérivatif, de quoi combler ma propre vacuité, une tangente par laquelle je pourrais fuir et enjamber l’existence ennuyeuse que je menais dans l’enfer des boulevards cosmopolites. La vie urbaine est symétrique et monotone, ses rues sont encombrées de panneaux publicitaires et de slogans péremptoires: «Paris est emphatique et alignée», disait Louis Veuillot. Elle s’est vidée d’un trait unanime et sans partage de tout ce qui pouvait entraver sa servitude. Ainsi, par distillation successive et jusqu’à parvenir à l’obtention d’un liquide docile et uniforme on fit maison nette de ses charmes singuliers en congédiant ses particularismes. Naïvement j’ai cru pouvoir échapper à cet enfer par la contemplation des chefs-d’œuvre qui s’offraient à mes yeux dans le musée. Hélas, dans mes premiers vagissements philosophiques, j’ai succombé, à mon grand dam, aux sirènes baroques du romantisme. En entrant dans le musée je quittais un espace saturé pour un autre. Sollicité de toutes parts, mes yeux roulaient dans leur orbite sans parvenir à se fixer nulle part. À chaque objet était rattachée une plaquette ludique et explicative dotée d’un code couleur bien spécifique. Des inscriptions sur le sol indiquaient la marche à suivre de laquelle il ne fallait déroger sous aucun prétexte, au risque de se faire rabrouer. Des images étaient projetées sur les murs, et durant toute la visite nous avions droit à une nappe sonore angoissante supposée concourir à l’immersion du client dans l’univers féérique de l’exposition. Ergotage muséographique ! Je suffoquais, harcelé par ce bruit infantilisant qui accompagne les choses, qui vous prend par la main et vous décrit par le menu ce que vous avez pourtant sous les yeux, qui vous dit où aller et quoi penser. J’avais besoin de solitude, de silence et de recueillement, mais le musée, au lieu de concourir à cette quête existentielle, participait à la conspiration universelle, cette conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure dont parlait Bernanos.
Martin Renatus