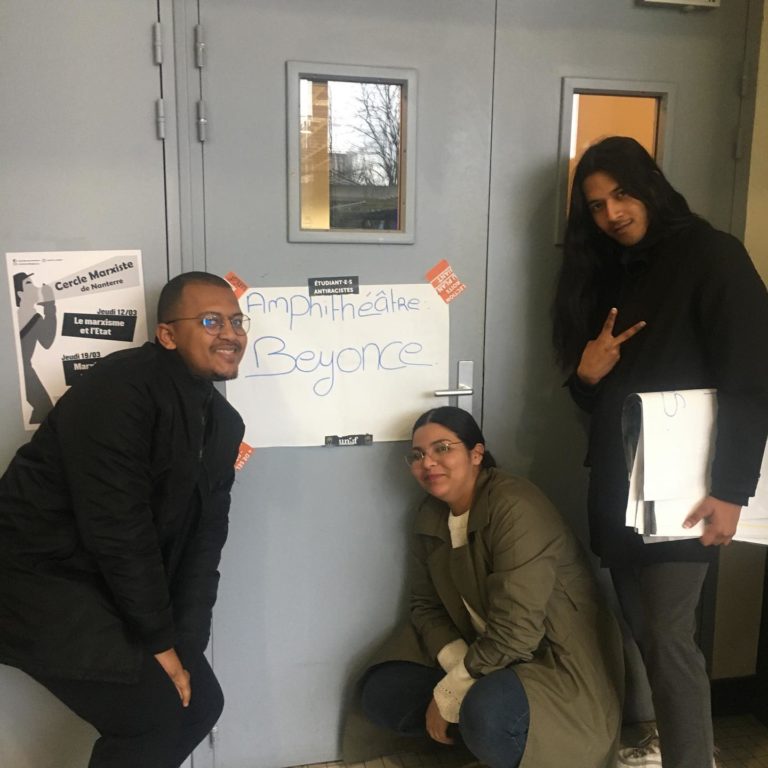Après être revenus dans une première partie sur quelques préliminaires nécessaires, nous entendons dans cette seconde partie entrer dans le vif du sujet : qu’est-ce qui constitue la nature du Bien commun ?
I. Le Bien Commun, une troisième voie philosophique
Puisque l’homme est par nature ordonné à la société politique, participer à la vie de la Cité dont il est membre ne relève pas d’une détermination contingente, mais bien de son Devoir.
Mais, pour agir politiquement, il faut commencer par considérer quelle est la raison d’être de la vie politique, sa finalité ou cause finale. Or, la fin d’une chose est son bien (une chose tend naturellement vers sa fin, et « bonum est quod omnia appetunt », le bien est ce que toutes les choses appètent) ; et, la fin d’une communauté, c’est la fin commune à tous les membres de cette communauté. C’est pourquoi la cause finale de la communauté politique est le Bien Commun.
En tant que bien du Tout, ce Bien Commun est distinct des biens particuliers de chacun des membres du corps social, et il leur est objectivement supérieur : le bien du tout vaut mieux que le bien de chacune des parties. Mais, en tant que bien de tous, il est pour ainsi dire le meilleur bien de chacun des membres de la communauté, puisqu’un bien est d’autant plus grand qu’il est commun.
Or un tel bien ne peut être que spirituel (par opposition aux biens matériels) : plus on partage une somme d’argent, plus les parts qu’auront les bénéficiaires de ce partage seront petites ; au contraire, plus on partage un savoir, plus ce savoir grandira, y compris chez ceux qui le partagent. Telle est la perspective aristotélicienne : les hommes, enseigne Aristote, s’unissent entre eux non seulement pour survivre mais aussi et surtout pour bien vivre, c’est-à-dire pour vivre en conformité avec leur nature humaine, qui est nature intellectuelle, ou rationnelle.
Ce Bien Commun, il est vrai, est en partie réalisé lorsque la société parvient, grâce à l’effort de tout, à une situation économique, qui apporte, pour chacun, un minimum d’aisance matérielle. Car le Bien Commun suppose le bien de chacun, et c’est ce qui justifie – contre le communisme – l’existence de la propriété privée. Propriété qui n’est pas dans cette perspective un « droit individuel » – contre le libéralisme, – mais une condition sine qua non de la réalisation du bien de la communauté.
Cependant, contre ces deux formes de matérialisme que sont le communisme et le libéralisme, la vie matérielle des membres de la communauté politique n’est pas la finalité de cette dernière : une société n’atteint ce pour quoi elle est faite que lorsqu’y règnent la justice, la paix, et, en fin de compte, l’amitié politique – raison d’être ultime de la société.
II. Garantir la justice et la paix
Sans la justice et la paix, il n’est point de Bien Commun.
La justice est, premièrement, la situation dans laquelle tous les membres de la communauté possèdent effectivement tous les biens matériels (propriétés) et immatériels (honneurs) qui leurs sont dus, ceux auxquels ils ont droit, non par nature, mais par leur mérite. On parle parfois de justice sociale. La justice est une valeur négative : elle se ramène, au fond, à ne pas causer de tort à autrui.
La paix, quant-à-elle, peut être sobrement définie comme l’absence de conflit ; c’est, elle aussi, une valeur négative. Elle suppose d’une part l’absence de conflit entre les membres de la communauté (paix intérieure) et d’autre part l’absence d’agression étrangère (paix extérieure). Ces deux aspects sont pris en charge par les deux institutions les plus fondamentales de la société : la police et l’armée. L’une et l’autre exercent, par définition, une certaine violence (voire l’élimination de l’ennemi) ; mais cette violence est justifiée (et n’est justifiée que) par la nécessité de maintenir la paix, condition sine qua non de l’amitié politique.
III. L’amitié politique, essence du Bien commun
L’amitié politique, qui est la seule valeur strictement positive parmi les trois constituantes du Bien Commun, peut être définie comme une bienveillance réciproque entre l’ensemble des membres de la Cité, car « la bienveillance, quand elle se montre réciproque, se nomme amitié » (Aristote, Ethique, VIII, 2). Un homme seul ne peut être heureux, car la solitude est contraire à la nature sociale et politique de l’homme ; il n’y a de bonheur que dans l’amitié, et de bonheur parfait que dans l’amitié parfaite, qui est l’amitié politique, parce que la seule qui actualise l’ensemble des puissances de la nature humaine (raison, volonté libre, cœur).
L’amitié, c’est d’abord une volonté : c’est vouloir le bien de l’autre, c’est-à-dire son bonheur réel. Mais cette volonté, pour être effective, doit se traduire par des actes. Elle peut consister, s’il le faut, à renoncer à son propre bien, afin de pourvoir au bien – physique ou moral – de l’autre. Elle peut même aller jusqu’à donner sa vie pour l’autre ; et c’est précisément le plus bel acte d’amitié politique qui soit que de mourir pour la Nation dont on est membre, que de mourir pour cette « unité de destin dans l’Universel » (José Antonio Primo de Rivera) dont on fait partie, que de mourir pour ceux qu’on aime – de volonté et de cœur – parce qu’on partage avec eux la même destinée morale et politique. L’amitié, si l’on y réfléchit bien, est la raison d’être ultime de la société politique : c’est lorsque les membres de la société entretiennent entre eux des liens authentiques d’amitié, et seulement dans ce cas, que la société réalise pleinement ce pour quoi elle est faite. Aristote fait d’ailleurs remarquer que « l’amitié est la principale sollicitude des législateurs, tandis qu’ils cherchent tout particulièrement à bannir la discorde, ennemie de l’amitié (Ethique, VIII, 1).
Elle est donc le constitutif formel, la nature ou l’essence-même, du Bien Commun de la Cité.